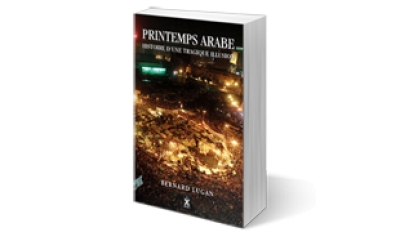Le maquillage d’une tragédie : l’expression le printemps arabe
Bernard Lugan attaque cette expression romantique qu’est le printemps arabe, affirmant qu’elle n’est ni printemps, ni arabe. En relatant la chronologie des escalades de conflits en Tunisie, en Égypte et en Libye, il explique pourquoi ces pays ont vécu des luttes internes destructrices, tandis que l’Algérie et le Maroc les ont évitées. En présentant un récit riche en détails, Lugan reste fidèle aux faits, sans trop virer vers l’interprétation.
Tout d’abord, l’expression elle-même : le printemps arabe. Les média de masse se sont maladroitement inspirés de l’expression ‘révolution de jasmin’, décrivant les réformes de 1987 en Tunisie apportées (ironiquement) par Ben Ali et axées sur la libéralisation du marché et l’égalité des sexes. Rien à voir avec les révoltes populaires de fin 2010, cris de détresse contre la brutalité policière, la corruption des politiques, la faim et le chômage.
Le terme printemps, une allusion au triomphal réveil de la nature, est difficilement applicable aux conséquences désastreuses des conflits tunisien, libyen et égyptien, marqués par le chaos politique et social. Pourquoi maquiller la réalité? Si ce printemps est réellement une sortie du froid, de l’hiver, aux yeux de qui l’est-elle?
L’auteur questionne également le rapprochement fait entre ces conflits et l’identité arabe, surtout qu’à l’époque les révoltes populaires étaient circonscrites à la Tunisie, la Libye et l’Égypte. La crise a été qualifiée d’arabe, et non de musulmane, nord-africaine ou même berbère, sans qu’elle ait toutefois gagné l’ensemble des pays arabes, ou arabophones, qui se chiffrent dans la vingtaine.
L’auteur souligne les différences entre les conflits, notamment que les cas tunisien et égyptien se sont déroulés sur fond de crise sociale par des soulèvements populaires, tandis que la Libye a été le théâtre de conflits claniques suivi par une succession d’interventions militaires étrangères. Dans les cas de la Tunisie et de l’Égypte, la corruption entourant les présidents Ben Ali et Moubarak, la Loi sur les mesures de guerre, ainsi que la brutalité et les abus de la police ont au fil des années créé un climat de tension, un abcès que la hausse des denrées alimentaires tels le blé ont crevé. Dans le cas de l’Égypte, l’asservissement de la clique Moubarak aux volontés de la Banque Mondiale et du FMI a créé une dépendance à l’import du blé, laissant le pays vulnérable aux augmentations de prix. Pour ce pays de 80 millions d’habitants, la moitié ayant moins de 25 ans, la cherté subite du pain a mit le feu aux poudres. La place Tahrir s’est vite allumée.
En Libye, la paix intertribale soigneusement maintenue par Kaddafi a été fragilisée, aboutissant à des revendications territoriales surtout en Cyrénaïque, le nord-est du pays renfermant 70% des richesses pétrolières et ancien siège du royaume d’Idriss 1er de l’ère pre-Kaddafi. Une lutte entre forces gouvernementales et rebelles s’est vite embrasée. Villages et ports ont changé de mains, les forces gouvernementales mieux équipées reprenant les dessus sur les rebelles et amorçant leur avancée vers le château-fort des rebelles, Benghazi, jusqu'à ce qu’une intervention militaire étrangère ne vienne assainir un coup fatal à l’armée et donner le pays aux rebelles, réunis sous la bannière du Conseil national de transition (CNT).
Le dénominateur commun devient donc l’éclosion quasi-simultanée de toutes ces crises, regroupées par les media occidentaux sous la bannière du printemps arabe.
Analyse
Autre que leur simultanéité, ces crises ont-elle un lien unificateur méritant une telle expression rassembleuse? Si oui, il leur faut soit un catalyseur commun, un dénouement commun ou les deux. Le livre de Lugan démontre que les éléments déclencheurs des différentes crises sont disjoints. Existe-t-il alors un résultat commun? Au moment de la rédaction de ce billet (septembre 2014), nous pouvons compter parmi les conséquences de ces crises (entres autres) la fragilisation des nations concernées, l’affaiblissement de leurs économies, une montée islamiste de certaines factions et dans certains cas de gouvernements entiers, comme en Tunisie ainsi que dans l’Égypte post-Moubarak, mais avant la reprise du contrôle par les militaires en début 2014. Sans mentionner le coût social : familles qui pleurent leurs morts, pertes d’emploi, suspension des cours d’écoles, effritement de la société civile, désirs de vengeance etc. Les crises du printemps arabe ne partagent donc aucun élément déclencheur, ni de conclusion positive politique ou sociale.
Pourquoi alors ces crises ont-elles toutes fait irruption en même temps? S’agit-il d’influences étrangères autres que le travail de désinformation des média (occidentaux, pétromonarchies etc.) et les interventions militaires de l’OTAN (e.g. Libye) une fois la crise déclenchée?
La quasi-simultanéité des crises écarte le hasard et revête une importance capitale dans la compréhension de la cause (ou des causes), d’autant plus que la Syrie, Bahreïn, l’Arabie Saoudite et le Yémen ont toutes dû composer avec des crises internes aussi. L’étude de Lugan aurait gagné à traiter de ces cas comme ceux du nord de l’Afrique, surtout le cas syrien, qui s’est gravement détérioré depuis la fin du printemps arabe et se propage aujourd’hui au nord de l’Irak. Ayant abordé chacun des cas, l’analyse globale aurait ensuite suivi un cours naturel vers l’origine commune des crises.
Un deuxième tome serait nécessaire pour aborder les cas syriens et irakiens, les hostilités en Afrique sahélienne suite à la disparition de l’état libyen, ainsi que le sort des pays nord africains dans l’ère post-printemps arabe.
Printemps arabe - histoire d’une tragique illusion, Édition Bernard Lugan, 2013